Paul Auster - "Tombouctou" |
Armand Monjo - Lettres du jardin L'héritier de Char |
Alain Demouzon - "Histoires féroces" Une fraternité barbare |
Monique Laforce - Des lilas à ciel ouvert Un indiscible parfum d'au-delà |
| Geneviève Brisac - " Pour qui vous prenez-vous ?" En pointillés | Horia Badescu - "Abattoirs du silece" |
| Julio Cortázar - "Marelle" Indépassable ! | Lucie Petit - Mosaïques Petit poucet |
Marie Desplechin - " Dragons" Le bonheur à en mourir |
Oeuvre poétique, peintures & dessins de Béatrice Douvre D'outre-tombe |
| Alan Bennett - La mise à nu des époux Ransome Subtile cruauté ! | "Sur la plage de Chesil" de Ian McEwan Dans le secret des cœurs et des corps |
| Marie Nimier - "La reine du silence Une évidence. | |
"L'homme qui tombe" de Don De Lillo La chute de l'Occident |
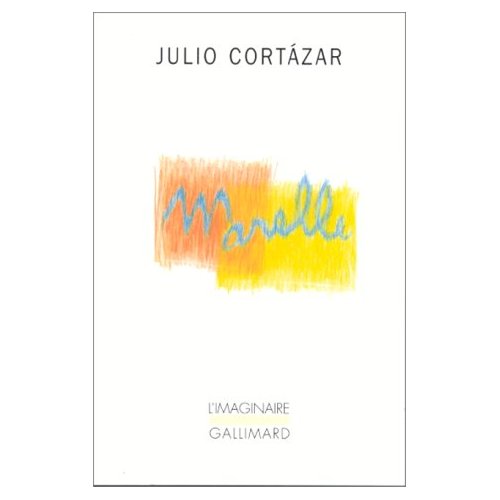
Marelle de Julio Cortázar
"La realidad para ser
necesita la imaginación."
(Pour que la réalité soit,
elle a besoin de l'imagination)
Roberto Juarroz - Quatorzième poésie verticale
José Corti (Ibériques)
On aurait dit que...
C'est ainsi que commencent les jeux d'enfants.
On aurait dit que c'était un roman. Un roman et un essai. Un roman, un essai et une digression.
On aurait dit qu'il faisait 363 pages divisées en 56 chapitres. Et aussi 591 pages divisées en 155 chapitres.
On aurait dit que ça parlait d'amour (entre Horacio Oliveira et la Sibylle):
"... ton amour me tourmente, car il ne me sert pas de pont, jamais Wright ou Le Corbusier ne feront de pont soutenu d'un seul côté... " (1).
"Tu me regardes, tu me regardes de tout près, tu me regardes de plus en plus près, nous jouons au cyclope, nos yeux grandissent, se rejoignent, se superposent, et les cyclopes se regardent, respirent confondus, les bouches se rencontrent, luttent tièdes avec leurs lèvres, appuyant à peine la langue sur les dents, jouant dans leur enceinte où va et vient un air pesant dans un silence et un parfum ancien. Alors mes mains s'enfoncent dans tes cheveux, caressent lentement la profondeur de tes cheveux, tandis que nous nous embrassons comme si nous avions la bouche pleine de fleurs ou de poissons, de mouvements vivants, de senteur profonde. Et si nous nous mordons, la douleur est douce et si nous sombrons dans nos haleines mêlées en une brève et terrible noyade, cette mort instantanée est belle. Et il y a une seule salive et une seule saveur de fruit mûr, et je te sens trembler contre moi comme une lune dans l'eau." (2)
On aurait dit que ça parlait d'amour et de littérature, et du monde, et de l'impossible équation qu'ils forment. Et aussi d'exil, dès la première page, avec cette citation de Jacques Vaché dans sa "Lettre à André Breton" en exergue : "Rien ne vous tue un homme comme d'être obligé de représenter un pays".
D'exil et de l'homme. De l'homme et de sa place, partout et nulle part.
On aurait dit que ça racontait la vie d'Horacio Oliveira, exilé argentin, à Paris entouré du Club de ses amis, obsédés par un écrivain élusif, Morelli, puis à Buenos Aires, de retour sans être de retour. On aurait dit que ça parlait aussi de l'écriture et de la littérature, et de la lecture et de la façon de pulvériser tout cela pour justement les faire exister.
On aurait dit que ça s'appelait Marelle. Entre "terre" et "ciel", "paradis" et "enfer".
Ce livre protéiforme est le seul à ma connaissance qui comportât des "chapitres dont on peut se passer" (57 et suivants). Chapitres dont on ne peut se passer en réalité tant ils enrichissent, approfondissent et éclairent le récit. Ces digressions qui n'en sont pas entraînent une lecture erratique, sautant de chapitre en chapitre comme de case en case, de la première partie du livre (selon une lecture linéaire suivie) à la seconde partie (dans un ordre prédéfini mais discontinu).
Ce mélange apparemment désordonné et spontané répond en réalité à un ordre pensé par l'auteur, parallèle à cet autre cheminement en apparence désordonné que sont la pensée et la vie.
Dans cette quête tourbillonnante de soi, de la vérité (ou d'une vérité, ou d'un mensonge suffisamment acceptable), le lecteur a un sentiment d'apesanteur. Contrairement à tout autre livre, le marque page n'indique plus la progression de la lecture : il avance et recule en une chorégraphie complexe mais jamais déconcertante.
Cortázar nous fait ainsi remonter de case en case, pardon, de page en page jusqu'à l'origine non pas du monde ou de l'être mais de l'idée, et partant de là, de la littérature. En invitant en quelque sorte le lecteur à être partie prenante de la création littéraire par son acte même de lecture, Cortázar concrétise un lieu commun. Et en même temps il essaye de cerner les différentes manières de traduire, et même de concevoir, la réalité dans la littérature. Cette technique s'apparente au puzzle chez cet auteur qui n'a jamais cru aux coïncidences : "Il n'est pas rare que (...) la présentation successive de plusieurs phénomènes hétérogènes crée instantanément une saisie des choses d'une homogénéité éblouissante" (3).
Dans une interview à Marcel Belanger sur le site Nuit blanche, Cortázar déclare : "Je suis très content d'être plongé dans la réalité ; et la réalité me donne énormément de choses. Ceci dit, dès l'enfance, mon idée de cette réalité n'était pas la même que celle de mes camarades (...) Ils savaient déjà ce qu'était une chaise, un crayon, leur maman. Et pour moi, tout était un peu flou, c'est-à-dire que tout le temps j'avais une impression poreuse de la réalité (...) Pour moi en tout cas c'est une espèce d'immense éponge pleine de trous, et par ces trous il se glisse tout le temps des éléments, des prétendues coïncidences, qu'on appelle le hasard aussi, qui la modifie, qui la fait basculer, qui la fait changer."
Cette appréhension de la réalité (au sens tactile du terme) n'est donc pas une simple affaire. Elle change radicalement selon les êtres ainsi que l'exprime Oliveira à propos de lui et de la Sibylle : "Je décris, je définis et je désire ces fleuves, elle les nage." (4).
Après l'impossibilité de partager cette perception du réel, c'est l'impossibilité de la retranscription de ce réel en littérature sur laquelle buttent les personnages de Marelle. Morelli, le double littéraire de Cortázar, s'interroge au fil de ses notes qui viennent entrecouper le récit linéaire, sur la possibilité de dynamiter la littérature telle qu'on la connaît pour arriver à des formes nouvelles plus fidèles ou au contraire émancipées du réel.
"Arriver par provocation à un texte bâclé, désordonné, incongru, consciencieusement antilittéraire (mais non anti-romanesque) et l'assumer. Sans s'interdire les grands effets qu'autorise ce genre quand la situation le requerra, se souvenir du conseil gidien : ne jamais profiter de l'élan acquis. Comme toutes les oeuvres où se complaît l'Occident, le roman se satisfait d'un ordre fermé. Résolument à l'opposé, chercher ici aussi une échappée et pour cela supprimer catégoriquement toute construction systématique de caractère ou de situation. Une méthode : l'ironie, la constante autocritique, l'incongruité, l'imagination à rien asservie." (5)
Ce à quoi, dans l'entretien avec Marcel Belanger , Cortázar répond en écho : "j’assimile la nouvelle à la notion de la sphère, la sphère comme corps géométrique parfait, qui est absolument fermé sur lui-même dans la perfection, parce que pas un seul point ne peut dépasser sa surface. Ça, c’est le symbole de la nouvelle. Une nouvelle est une chose fatale, un récit très court qui doit se boucler d’une façon parfaite, comme une sphère, pour être vraiment une nouvelle telle que je l’entends. Par contre, le roman n’est jamais une sphère. Le roman est ce que Umberto Eco appelle l’œuvre ouverte, c’est-à-dire la possibilité de se déplier, de bifurquer. Le roman est un arbre, et la nouvelle est une sphère."
Rejoignant le "voyant" de Baudelaire et de Rimbaud (6), mais un voyant incertain, humble et non triomphant, l'écrivain reste cependant intrinsèquement lié au lecteur :
"Je me demande, quant à moi, si je parviendrai une bonne fois à faire comprendre que le véritable et l'unique personnage qui m'intéresse c'est le lecteur, dans la mesure où un peu de ce que j'écris devrait contribuer à le modifier, à le faire changer de position, à le dépayser, à l'aliéner." (7)
Echo à peine déformé de ce que dit Cortázar dans ses entretiens, à savoir que l'écriture est un acte révolutionnaire dans la mesure où l'on ne peut transformer l'homme qu'en transformant ses instruments de connaissance.
Ce à quoi, dans l'oeuvre ouverte qu'est Marelle, Cortázar et Morelli s'attachent à réaliser en s'attaquant à la fois à la forme du récit et au langage même de la narration. Par le livre lui même avec cette déstructuration (très structurée au demeurant) en chapitres entrelacés (8) ou phrases longues d'une page ou deux, une narration tantôt impersonnelle, tantôt le fait d'Oliveira, tantôt celui de l'un de ses amis, tantôt encore remplacée par des dialogues. Et dans le livre avec les interrogations perpétuelles de Morelli sur le langage et comment arriver à une simplification purificatrice : "Ce que Morelli veut, c'est rendre ses droits au langage. Il parle de l'expurger, de le châtier, de remplacer "choir" par "tomber", simple mesure hygiénique. Mais ce qu'il cherche, au fond, c'est rendre au verbe "choir" tout son éclat pour qu'on puisse l'utiliser comme j'utilise des allumettes et non comme un motif décoratif, un morceau de lieu commun." et plus loin "La seule chose claire dans tout ce qu'a écrit le vieux c'est que, si nous continuons à employer le langage dans son registre courant, avec ses finalités courantes, nous mourrons sans avoir su le véritable nom du jour." et encore: "Distinguons plutôt entre langage expressif, autrement dit le langage en soi, et la chose exprimée, autrement dit la réalité devenant conscience."(9). Interrogations qui font écho à celles sur la structure du récit : "Morelli essayait quelque part de justifier ses incohérences narratives, soutenant que la vie des autres, telle qu'elle nous apparaît dans ce qu'on appelle la réalité, n'est pas du cinéma mais de la photographie, c'est-à-dire que nous ne pouvons appréhender l'action que fragmentairement, par recoupements éléatiques." et plus loin "En lisant son livre, on avait l'impression que Morelli avait espéré que l'accumulation des fragments se cristalliserait brusquement en une réalité totale. Sans avoir à inventer de ponts, ou coudre les différents morceaux du tapis, il y aurait tout d'un coup une ville, un tapis, des hommes et des femmes dans la perspective absolue de leur devenir, et Morelli, l'auteur, serait le premier spectateur émerveillé de ce monde qui accédait à la cohérence." (10). Ce qui n'est ni plus ni moins que ce que postulait Cortázar plus haut et ce qu'il tente (et selon moi réussit) de faire dans Marelle. Pour une mise en abîme vertigineuse. "Comment raconter sans cuisine, sans maquillage, sans clins d'oeil au lecteur ? Peut-être en renonçant à sous-entendre qu'une narration est une oeuvre d'art. La sentir comme nous sentons le plâtre que nous versons sur un visage pour en faire un moulage. Mais le visage devrait être le nôtre." (11).
Il ne faut pas s'étonner alors si Marelle en particulier, et l'écriture de Cortázar en général, est empreinte (imbibée oserais-je dire) de jazz. Ainsi que l'expose mieux que je ne saurai jamais le faire Philippe Fréchet (12), dans la structure et le rythme du jazz, Cortázar trouve l'illustration même de ce qu'il attend de l'écriture (13). Musique qu'il place finalement à l'origine même de l'écriture : "Il y a d'abord une situation confuse, qui ne pourra se définir que par le mot ; je pars de cette pénombre, et si ce que je veux dire (si ce qui veut être dit) a suffisamment de force, immédiatement le swing, le branle est donné, un balancement rythmique qui me fait émerger à la surface, illumine tout, fond cette matière confuse et celui qui en est la victime en une troisième instance claire et pour ainsi dire fatale : la phrase, le paragraphe, la page, le chapitre, le livre. Ce balancement, ce swing dans lequel la matière confuse prend forme, est pour moi l'unique preuve de sa nécessité, car à peine a-t-il cessé je comprends que je n'ai plus rien à dire." écrit Morelli dans Marelle. "Personne n’a pu expliquer ce qu’est en fait le swing. L’explication la meilleure est que dans une mesure à quatre temps, le musicien de jazz avance ou retarde instinctivement ces temps qui, selon le chronomètre, devraient être égaux. Alors une mélodie qui, chantée comme elle a été composée, avec ses temps bien marqués serait banale, si un musicien de jazz s’en empare et modifie son rythme par l’introduction de ce swing, devient aussitôt porteuse d’une tension. [...] Et, mutatis mutandis, c’est ce que j’ai toujours essayé de faire dans mes nouvelles. J’ai essayé que la phrase non seulement dise ce qu’elle veut dire, mais qu’elle le fasse d’une manière qui renforce le sens, qui l’introduise par d’autres voies non plus dans l’esprit mais dans la sensibilité du lecteur [...] Le rythme de la phrase — et c’est là qu’intervient la musique — agit sur le lecteur sans qu’il s’en doute. Cela explique [...] ce qui arrive à la fin de mes nouvelles, l’importance que j’attache à leur rythme final. Il ne peut y avoir là ni un mot, ni un point, ni une virgule, ni une phrase de plus. La nouvelle doit arriver aussi fatalement à sa fin qu’une grande improvisation de jazz" répond Cortázar (14) qui précise dans les mêmes "Entretiens..." que le jazz était la seule musique qui rejoignait l'écriture automatique et lui donnait un équivalent musical du surréalisme.
De ce livre débordant, drôle, exigeant, reste en définitive le sentiment pour le lecteur d'avoir été porté à la hauteur de l'écrivain. Parce qu'ici comme dans toute son œuvre, ce qui caractérise Cortázar, c'est son immense respect et sa confiance en l'intelligence humaine. Il a pu être "accusé" d'hyperintellectualisme, et c'est vrai que le bonhomme était d'une culture encyclopédique et d'une curiosité insatiable, mais c'est prendre l'équation par le mauvais bout. Cortázar part du postulat que le lecteur est intellectuellement son égal et, grâce à cela, nous le devenons (même si ce n'est que l'espace d'une lecture en ce qui me concerne). Roman faussement interactif, Marelle est véritablement initiatique : il ouvre le monde, ou plutôt les mondes, au lecteur.
"Une marelle sur le trottoir ; craie rouge, craie verte. CIEL. Le sentier, là bas, à Burzaco, le petit caillou si soigneusement choisi, le coup bref avec la pointe du soulier, doucement, doucement, et bien que le Ciel soit proche, toute la vie devant soi." (15).
(1) Chapitre 93, p.441.
(2) Chapitre 7, p.43.
(3) Voir l'article consacré à Cortázar dans l'Encyclopaedia Universalis CD-ROM version 3, 1997, écrit par Jacqueline Outin et Jean-Pierre Ressot et cité sur le site : http://sentiers-nte.univ-lyon2.fr/~mortier/deug2/exos/textesenvrac/cortazar.html
(6) Chapitre 84, p.422 : "Le bonhomme, d'ailleurs, continue d'être convaincu que rien d'intéressant ne lui échappe jusqu'à ce qu'un léger déplacement quelconque lui montre, l'espace d'une seconde, sans malheureusement lui laisser le temps se savoir quoi
lui montre son être morcelé (...)
l'intuition que plus loin, où je ne vois à présent que l'air limpide,
ou bien dans cette indécision, au carrefour du choix,
dans le reste de la réalité que j'ignore
je suis entrain de m'attendre inutilement."
(8) Y compris jusqu'au sein même d'un chapitre 34 où les lignes des premières pages d'un roman de gare que lisait la Sibylle sont mêlées aux lignes des pensées d'Oliveira au sujet de la Sibylle lisant cette "sous-littérature". Le tout en une alternance qui dans sa différence même se rejoint l'espace d'un mot ou d'une expression qui fait écho.
Tout comme la partie récit et la partie essai du livre se rencontrent au chapitre 154 lorsque Oliveira rencontre Morelli... Ou comme Marelle rejoint un autre livre de Cortázar "62. Maquette à monter" dont la trame part du chapitre 62 de Marelle.
(9) Chapitre 99, p. 458, 461 et 467.
(10) Chapitre 109, p.488 et 489.
(12) Dans "Le tour du jazz en Cortázar", in Europe, n°820-821, août-septembre 1997, p.117-123. http://www.citizenjazz.com/article1234113.html
(13) Lire ce chef d'oeuvre rythmique qu'est la longue phrase du chapitre 17, p.78-80 où jamais le fond et la forme ne se sont plus harmonieusement épousés.
(14) Dans les "Entretiens avec Omar Prego" - Gallimard (Folio/Essais-Inédit n°29) cité par Philippe Fréchet dans son "Tour du jazz..."
Marelle de Julio Cortázar
ed. Gallimard (L'imaginaire)
ISBN-13: 978-2070291342